Une nouvelle étude examine qui est pris en compte dans la surveillance de la COVID-19 et pourquoi cela est important
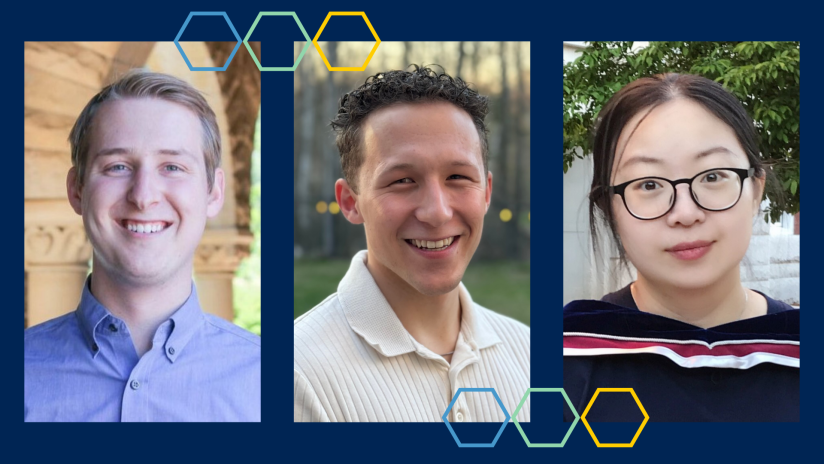
Qu’est-ce que cela signifie pour une étude sur la santé d’une population que celle-ci reflète véritablement cette population ?
C’est une question qui préoccupe les chercheurs depuis des décennies et qui est devenue plus urgente pendant la pandémie de COVID-19, lorsque des études à réponse rapide ont été lancées à travers le pays afin de surveiller les tendances de l’infection et d’éclairer les mesures de santé publique. Mais lorsqu’il s’agit de comprendre qui a été inclus dans ces données et qui a pu être exclu, de nouvelles recherches contribuent à combler les lacunes.
Une étude récente publiée dans BMC Public Health a examiné la composition sociodémographique de six grandes initiatives de sérosurveillance du SARS-CoV-2 menées au Canada entre avril 2020 et novembre 2023, dont une utilisant les données nationales CanPath. Dirigée par Matthew Knight, M.Sc., et le Dr W. Alton Russell, auteur principal, de l’Université McGill, l’étude révèle comment les stratégies de recrutement ont influencé la composition démographique des participants à l’étude, ce qui peut influencer les conclusions qui en sont tirées.
« Pendant la pandémie de COVID-19, les études de surveillance sérologique ont fourni des données essentielles pour aider les chercheurs à comprendre les tendances de l’infection et de l’immunité au SARS-CoV-2 », a déclaré M. Knight. « Cependant, les restrictions liées à la pandémie ont obligé ces études à recourir à des stratégies de recrutement créatives pour obtenir des échantillons sanguins à des fins de test, ce qui a donné lieu à une diversité de stratégies de recrutement, chacune ayant ses propres forces et limites. »
Cette diversité a constitué une occasion unique. « À partir des données de six études canadiennes de sérosurveillance du SARS-CoV-2, nous avons voulu évaluer dans quelle mesure la représentativité des études variait selon les stratégies de recrutement et les plans d’étude. Cela peut aider à éclairer les approches futures en matière de surveillance des maladies infectieuses en général, et pas seulement pour le SARS-CoV-2 », a expliqué M. Knight.
L’équipe a comparé l’âge, le sexe, la localisation urbaine/rurale, le niveau de privation matérielle et le statut racial des participants dans six études. Celles-ci comprenaient des cohortes longitudinales préexistantes telles que CanPath, des échantillons de commodité utilisant du sang résiduel et une cohorte d’enquête probabiliste nouvellement recrutée.
Des résultats surprenants, des écarts persistants
Bien qu’aucune étude n’ait atteint une représentativité totale pour tous les groupes, certaines méthodes de recrutement ont donné de meilleurs résultats que d’autres, et certaines conclusions ont contredit les attentes initiales.
« Nous avons été surpris de constater que certains sous-groupes démographiques étaient aussi bien, voire mieux, représentés dans les études utilisant de simples échantillons de commodité parmi les donneurs de sang ou les patients soumettant des échantillons pour des tests de laboratoire que dans les enquêtes de santé prospectives utilisant des stratégies de recrutement plus complexes », a déclaré le Dr Russell.
Les échantillons de commodité, ont-ils noté, peuvent éviter un défi majeur de nombreux efforts de recrutement traditionnels : le biais de non-réponse.
Mais ils sont généralement accompagnés d’une mise en garde : les chercheurs ne peuvent pas demander aux participants des informations contextuelles pouvant être utilisées pour caractériser la population et ajuster le biais de sélection. « Étant donné que l’échantillonnage de commodité est relativement peu coûteux par rapport à d’autres techniques d’échantillonnage, cela suggère que l’utilisation de dons de sang ou d’échantillons collectés régulièrement peut être une méthode rentable pour obtenir des populations d’étude représentatives dans des situations où les ressources sont limitées », a ajouté le Dr Russell.
« Mais ces échantillons de commodité présentent une limitation importante. Bien qu’ils soient moins coûteux et parfois plus représentatifs à certains égards, ils ne disposent pas d’une base d’échantillonnage pouvant être utilisée pour générer des pondérations d’échantillonnage. De ce fait, il peut être plus difficile de quantifier et de corriger le biais de représentation. »
L’étude a également confirmé les préoccupations concernant la sous-représentation systématique des groupes racialisés, un problème d’équité que les chercheurs en santé publique soulèvent depuis des décennies.
« Nous avons également été surpris de constater que certains sous-groupes minoritaires racialisés étaient sous-représentés dans chaque étude dans laquelle ils étaient évalués », a déclaré M. Knight. « Cependant, nous ne disposions pas des données nécessaires pour analyser l’origine ethnique et la race de l’échantillon de commodité chez les patients, qui aurait pu être mieux représenté […] par rapport aux donneurs de sang et aux participants à des études sur la santé comme CanPath. »
L’évolution du rôle des cohortes de population
CanPath — le Partenariat canadien pour la santé de demain — figurait parmi les six sources de données incluses dans l’étude. En tant que plus grande étude sur la santé de la population au Canada, CanPath recueille un large éventail de données sur la santé, le mode de vie, l’environnement et la biologie auprès de plus de 330 000 participants à travers le pays.
Dans le contexte de la surveillance pandémique, les cohortes telles que CanPath offraient un atout particulièrement précieux : une infrastructure et des populations participantes déjà en place.
« Les cohortes longitudinales ont joué un rôle essentiel en permettant une recherche réactive et en temps réel pendant la pandémie », a déclaré la Dre Jennifer Brooks, directrice générale de CanPath. « À un moment où les systèmes de santé étaient mis à rude épreuve, ces études ont permis d’agir rapidement et, comme nous l’avons vu ici, d’évaluer la représentativité de ces mesures. »
Les résultats soulignent également la nécessité de collecter de manière plus cohérente et plus rapide des données sociodémographiques, en particulier sur l’origine ethnique, afin de mettre en évidence les inégalités structurelles.
« L’identification des obstacles à la participation pourrait améliorer la représentation démographique et la détection des tendances sanitaires au sein des sous-groupes », a déclaré M. Knight. « Nous espérons que nos travaux souligneront également la nécessité de mesurer de manière plus cohérente l’identité raciale et ethnique au Canada afin d’améliorer l’évaluation des inégalités en matière de santé. »
Prochaines étapes : mettre en place un système de surveillance plus intelligent
À l’avenir, les chercheurs espèrent que ces résultats inspireront des changements, tant dans la conception des études que dans les infrastructures nationales.
« Il existe de nombreuses raisons impérieuses pour le Canada de maintenir et d’étendre cette infrastructure, cette infostructure et cette expertise en développant un réseau intégré de sérosurveillance pancanadien », a déclaré le Dr Russell, en référence à leur récent commentaire publié dans le Canadian Journal of Public Health. « Idéalement, un tel réseau pourrait obtenir rapidement des échantillons et des données provenant de diverses sources pour des analyses intégrées, y compris du sang résiduel à faible coût… parallèlement à des cohortes bien caractérisées comme CanPath. »
Ils soulignent également la nécessité de disposer d’outils méthodologiques plus solides et de liens plus rapides entre les données afin de soutenir une prise de décision représentative et équitable lors de crises futures.
« Idéalement, ces méthodes tireraient parti des riches informations disponibles sur les populations grâce aux données administratives », a ajouté le Dr Russell. « Actuellement, le couplage des données administratives est généralement possible au sein d’une province, mais les processus sont beaucoup trop lents pour faciliter la prise de décision en temps réel. »
CanPath reste déterminé à soutenir des recherches comme celles-ci en fournissant un accès libre à des données harmonisées et à des échantillons biologiques, en permettant le couplage avec des données administratives et environnementales, et en proposant des outils pour explorer les tendances en matière de santé et de maladie au niveau de la population.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Megan Fleming
Agente des communications et de l’application des connaissances
Partenariat canadien pour la santé de demain (CanPath)
info@canpath.ca